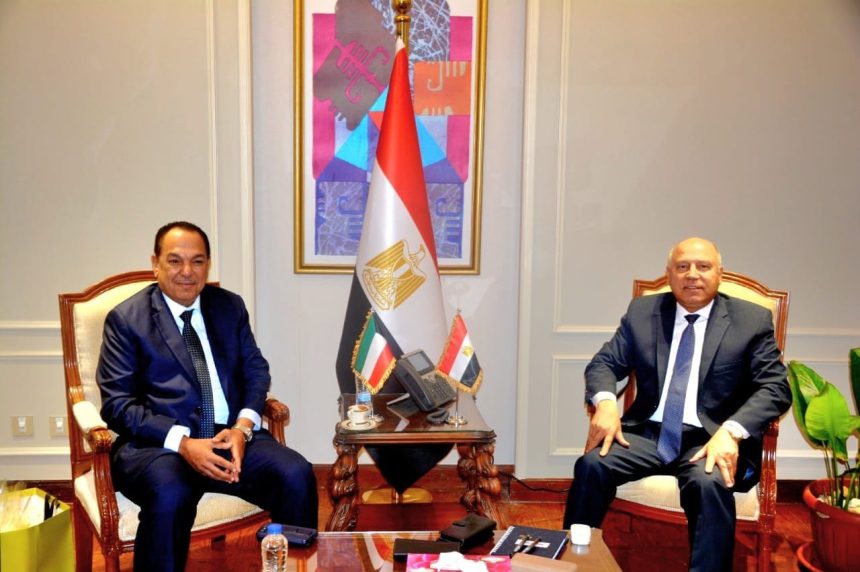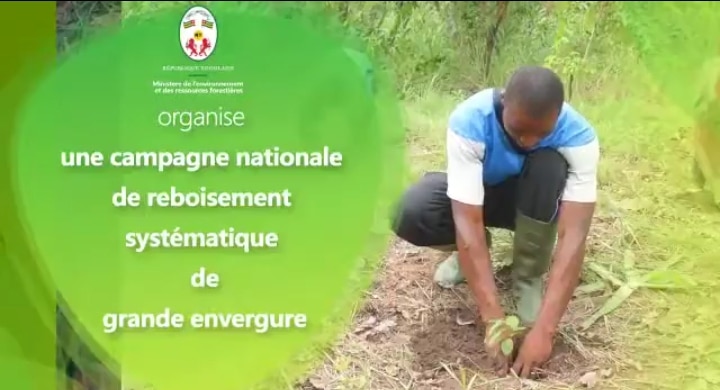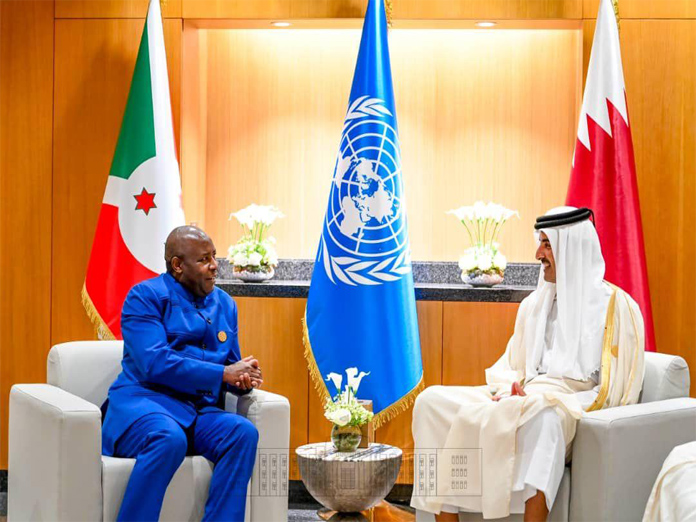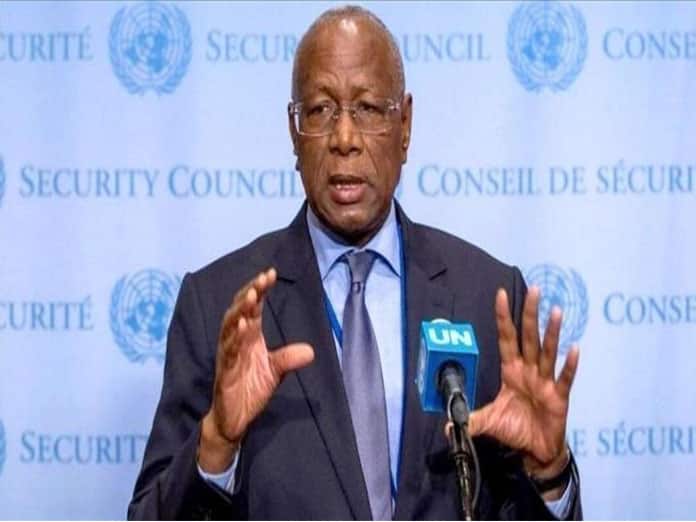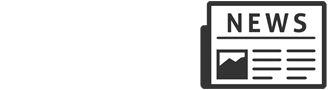La langue, c’est bien plus qu’un simple outil de communication ; c’est le cœur battant de l’identité. Ce jeudi à Lilongwe, la capitale, cette vérité a résonné aux portes mêmes du pouvoir. Une vague de militants, déterminés à renverser une relique de l’ère coloniale, a assiégé le Parlement pour exiger la fin de la règle du seul anglais dans l’enceinte législative. C’est une attaque frontale contre la suprématie linguistique qui dure depuis 61 ans d’indépendance.
L’assaut de l’identité : les détails du terrain
L’atmosphère est chargée d’une énergie palpable, à la fois festive et résolue. Loin d’une simple marche, c’est une démonstration de force culturelle. Les images sur place témoignent de la précision du message.
On a pu observer des manifestants brandissant des pancartes écrites avec un soin particulier, dont les slogans chocs : « Des langues locales pour des débats parlementaires enrichissants » et « Des langues autochtones pour l’inclusion ». Ces messages, formulés en anglais pour s’assurer qu’ils soient entendus par l’institution anglophone elle-même, soulignent ironiquement l’urgence de leur requête. Ils ne demandent pas l’exclusion, mais l’enrichissement et l’inclusion, reconnaissant que des débats menés dans la langue maternelle des députés pourraient être plus nuancés et plus proches des réalités de leurs électeurs.
La remise symbolique de la pétition
Le moment clé de la journée est sans conteste : la remise solennelle de la pétition aux parlementaires. Ce geste n’est pas seulement administratif ; il symbolise la passation directe du pouvoir de la rue à l’institution. Les militants, en scandant des slogans près du Parlement, exerce une pression sonore et visuelle, s’assurant que leur voix ne puisse être ignorée.
Le discours des leaders renforce la charge émotionnelle de l’événement. Un militant a insisté : Cette pétition témoigne de notre profonde conviction que le langage n’est pas simplement un outil de communication, mais un vecteur de culture, de mémoire et d’identité. Ce n’est pas une simple réforme procédurale qui est demandée, mais une réhabilitation historique et culturelle.
L’incohérence post-indépendance
Sylvester Namiwa, directeur du Centre pour la démocratie et les initiatives de développement économique (CDED), dont l’organisation a initié la démarche avec la Lost History Foundation (LHF), a mis le doigt sur l’incohérence fondamentale qui motive cette action. Il a déclaré, visiblement frustré :
Après près de 61 ans d’indépendance, nous devons nous interroger sur la raison pour laquelle nous devrions faire campagne dans les langues autochtones et envoyer ces membres, que nous prétendons être nos serviteurs, entrer dans la maison et commencer à mener des affaires en anglais
Cette observation est un commentaire cinglant sur la persistance des structures post-coloniales. Les députés, élus en langue locale auprès des populations, sont forcés de débattre dans la langue de l’ancienne puissance coloniale, créant un fossé linguistique et démocratique entre les représentants et leurs bases. La démonstration s’achève sur un engagement de la plus haute importance. Les militants maintiennent que les manifestations se poursuivront jusqu’à ce que leurs revendications soient satisfaites. La bataille pour la décolonisation linguistique du Parlement ne fait que commencer.