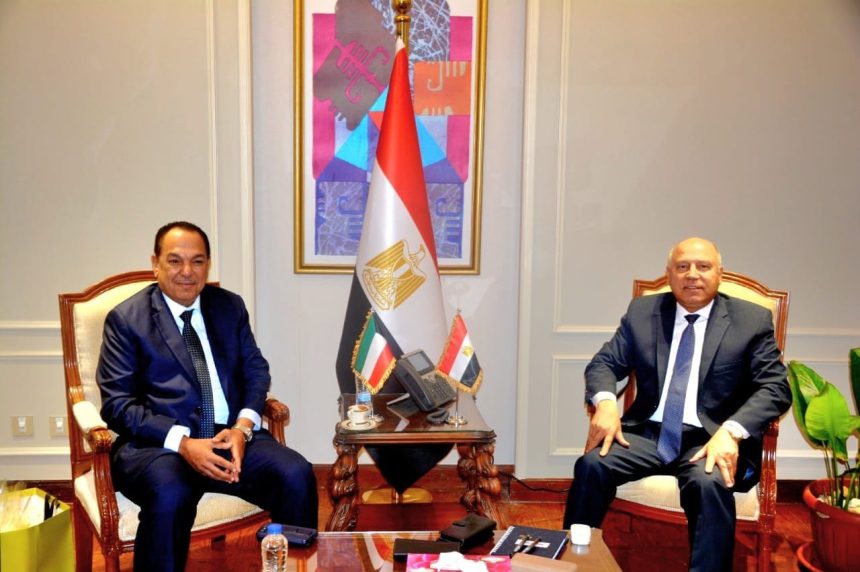Il aura fallu la double crise du Covid-19 et de la guerre russo-ukrainienne pour se rendre à l’évidence : l’économie africaine repose toujours à l’excès sur un modèle hérité de la colonisation, celui de l’extraction et de l’exportation de ses matières premières. Le continent a connu en 2020 sa première récession depuis trente ans. Les grands exportateurs de matières premières, Nigeria et Angola en tête, mais aussi toute l’Afrique centrale et australe, ont subi de plein fouet l’effondrement des cours des produits énergétiques lié à la pandémie.
Ceux-ci sont remontés en flèche dans le sillage de l’invasion russe en Ukraine mais un pays comme le Nigeria, pourtant le premier producteur de pétrole en Afrique, n’en profite guère : raffinant très peu son brut, il dépend presque entièrement des importations de carburant, ce qui rend le marché local vulnérable aux hausses de prix. Si le secteur tertiaire africain s’est modestement développé ces dernières années, il reste anecdotique en regard du secteur primaire : 80 % des exportations africaines proviennent encore des matières premières, pour la plupart non transformées. L’économiste britannique Richard Auty a popularisé en 1990 l’expression de « malédiction des ressources naturelles ». Trois décennies plus tard, celle-ci n’a rien perdu de sa justesse. De la Guinée à la République démocratique du Congo (RDC), en passant par le Nigeria, les pays les plus riches en matières premières continuent d’être aussi ceux qui, paradoxalement, ont le plus faible taux de croissance.
« En Afrique pour l’Afrique »
«Les Economies des pays moins riches en ressources naturelles est, par nature, beaucoup plus diversifiée », détaille Papa N’Diaye, chef de division au département Afrique du Fonds monétaire international (FMI). « Dans notre rapport de 2019, nous avons établi qu’ils avaient un taux de croissance moyen de 6 %, là où les pays riches en ressources naturelles plafonnaient à 3,1 %. » De surcroît, le continent africain a le secteur primaire au rendement moyen le plus faible de la planète. Conscients de leur absence de souveraineté industrielle, plusieurs pays africains ont tenté ces deux dernières années de développer un secteur pharmaceutique et de produire eux-mêmes les vaccins contre le Covid-19.
Six d’entre eux ont ainsi été choisis en février par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour héberger leur propre production de vaccins à ARN messager. Une initiative peu concluante : le 3 mai, le groupe pharmaceutique Aspen, qui s’était lancé dans la production et la commercialisation de vaccins en Afrique du Sud après un accord avec Johnson & Johnson, a annoncé réfléchir à mettre fin au projet faute de commandes. L’accord signé en novembre 2021 entre Aspen et J & J pour la fabrication de doses « en Afrique pour l’Afrique » avait pourtant été qualifié par l’OMS de « développement majeur » pour le continent. Pour l’économiste sénégalais Abdou Soulèye Diop, président de la commission Afrique de la Confédération générale des entreprises du Maroc, il faut tirer les leçons de cette séquence : « Je peux comprendre qu’un pays comme le Maroc, qui a une industrie pharmaceutique extrêmement développée, se mette à produire des vaccins. Mais on ne peut pas tous faire de même ! Quand le Covid va disparaître, que va-t-on faire de ces unités de production ? Non, il faut une vraie industrialisation réfléchie, opportuniste, avec une vision à long terme. ».
Il n’y a pas de solution miracle, reconnaît l’économiste. La transformation structurelle de l’économie doit passer par trois incontournables : augmentation de la productivité du secteur primaire, industrialisation, diversification. « Il faut se concentrer en priorité sur l’existant, insiste Abdou Diop. Ceux qui ont des fruits doivent les transformer localement : la mangue, la noix de cajou, l’ananas. Ceux qui ont de la bauxite doivent aller vers la transformation pour faire de l’alumine. Ceux qui ont de l’hévéa doivent produire leur propre caoutchouc. » Plusieurs pays africains ont déjà initié des politiques économiques prometteuses. Le Maroc et sa florissante industrie aéronautique, l’île Maurice, qui a diversifié une économie agricole reposant sur la culture de la canne à sucre en développant le secteur textile, le tourisme et les services financiers… Le Rwanda, le Togo, l’Ethiopie ou le Kenya ont aussi lancé des stratégies de diversification économique.
« Pour avoir une politique industrielle efficace, l’ensemble de l’appareil d’Etat doit être impliqué », résume l’économiste Carlos Lopes, ancien directeur de la Commission économique pour l’Afrique des Nations unies. « On ne peut pas traiter la politique industrielle comme une politique sectorielle. Si vous confiez cette tâche au ministère de l’industrie, il ne va jamais y arriver seul. Il faut une politique centrale, à laquelle participent l’Etat et l’ensemble des acteurs économiques, qui sélectionne et priorise quelques secteurs précis. »
L’Asie du Sud-Est, qui a connu une double vague d’industrialisation dans les années 1960 et 1980, fait figure de modèle. Indonésie, Malaisie, Thaïlande… « Ces pays choisissaient des chaînes de valeurs spécifiques», détaille Carlos Lopes, et alignaient l’ensemble des mécanismes de soutien pour qu’elles puissent se mettre en place rapidement. C’est ce que sont en train d’initier un certain nombre de pays africains dont je conseille les gouvernements. »
« Industrialisation durable »
Mais le continent ne pourra pas calquer point par point l’Asie du Sud-Est. Les pays africains arrivant en retardataires dans la course à l’industrialisation, les chaînes de valeur ne sont plus les mêmes qu’au XXe siècle : les règles du commerce mondial ont changé, évoluant vers plus de restrictions et de régulations, la propriété intellectuelle s’est concentrée dans quelques grands pôles situés dans un petit nombre de pays, les Etats n’ont plus la même latitude dans leurs politiques de financement. « Les pays africains ont moins d’options que les autres, résume Carlos Lopes. En revanche, ils peuvent s’industrialiser différemment, avec leurs atouts propres. » Le premier d’entre eux, selon lui, est la capacité à tirer profit des leçons du passé.
A l’ère de la prise de conscience de l’urgence écologique, le modèle d’industrialisation sud-est asiatique a montré ses limites. « Nous n’avons pas besoin de mettre en place tout ce que les autres sont en train de démonter pour le reconstruire autrement, veut croire l’économiste. Nous pouvons opter directement pour une industrialisation durable. » Car l’Afrique est riche des matières premières indispensables à des marchés porteurs, comme le cobalt, en RDC, un minerai essentiel pour la fabrication des véhicules électriques. La transition écologique pourrait fournir au continent une manne financière considérable, à condition d’éviter d’entrer dans un nouveau cycle d’exportations de matières premières non transformées. Surtout, les Africains sont en passe de devenir le premier marché de consommateurs au monde.
La population du continent pourrait passer de 1,2 milliard de personnes aujourd’hui à 2,5 milliards en 2050. « Ce qui va faire la différence, explique Carlos Lopes, c’est la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf). Le chantier a été ralenti par la pandémie, mais à partir du moment où elle sera mise en œuvre, nous aurons accès à un marché gigantesque, doté d’une importante classe moyenne, qui représente déjà 300 millions de personnes. C’est une fois et demie la population du Brésil. Et un marché jeune, qui plus est ! Les autres parties du monde ont des marchés matures, leurs populations sont vieillissantes. Bien sûr, grâce aux brevets, elles garderont l’essentiel de la valeur des produits à haute intensité technologique. Mais ces produits seront consommés par les jeunes, et les jeunes seront en Afrique. »